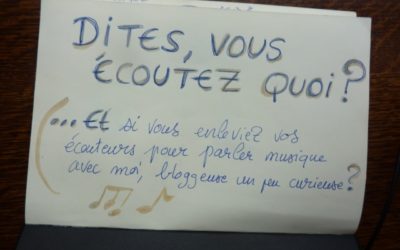« Depuis la chute de Saigon, j’ai compris que la vie était éphémère, elle est trop précieuse pour être un esclave. » Lui, c’est Kongo aka Cyril Phan, chapeau, cheveux en bataille, l’un des graffeurs français les plus connus et reconnus. L’un de ceux qui appartiennent désormais au marché de l’art contemporain. Pourtant le marché, il s’en fichait pas mal. « On n’avait aucun sens du marché de l’art, on s’en foutait, on ne s’adressait qu’aux graffeurs. On n’y connaissait rien. »
Kongo, on a eu envie de le rencontrer en écoutant Claude Kunetz, de la galerie Wallworks, dans le Xe arrondissement, nous en parler. Claude Kunetz est galeriste mais a également tenu pendant plusieurs années un centre culturel dans un hôpital psychiatrique. Il y a fait venir plusieurs graffeurs pour peindre avec les patients. « Kongo était l’un des premiers à répondre à l’appel. Très marqué par l’expérience, il voulait absolument qu’on trouve une galerie pour exposer les œuvres. »
« Je voulais poser une question : qui est fou ? Je voulais montrer les œuvres de personnes folles à des gens dits "normaux". Pourquoi une personne qui construit une centrale nucléaire sur une zone sismique ne serait-elle pas folle ? Pourquoi ceux qui cultivent la terre avec du poison ne seraient-ils pas fous ? Je suis très intéressé par l’art brut, les gens qui peignent, qui sculptent, sans aucune technique et seulement avec la volonté de s’exprimer et montrer quelque chose. »
Un narvalo à Narvaland
Cyril, c’est un nom français, comme sa mère. Phan, c’est vietnamien, comme son père. Le Vietnam où il vécut jusqu’à l’âge de six ans. Avant que sa mère ne l’envoie en Europe avec un faux passeport après la chute de Saigon. « J’étais un petit immigré en France. Je ne parlais pas bien la langue, j’étais timide, j’étais tout seul. Pour faire ma place, je prenais et je donnais pas mal de coups de poings. » Calme, serein, on l’imagine peu bagarreur.
Kongo évoque son enfance autour d’un café, dans son atelier de Bagnolet qu’il partage avec trois autres graffeurs "old-school" Lazoo, Colorz et Gilbert. Ce repaire, derrière un grand mur de façade graffé, c’est Narvaland. « Un narvalo, c’est un fou en rabouin, l’argot des gitans du 93 ».
Cet enfant du monde dessine depuis qu’il est gamin. Ado, il part avec sa mère à Brazzaville, au Congo. « Je rencontre des Libanais, des Camerounais, des Malgaches, des Algériens, des Sénégalais, des métisses, des expat’. Les premiers pétards, les premières meufs, les premières sorties. Tu marches en sandalettes. » La belle vie, « à l’africaine ».
Ses copains de Brazza partent à New York, reviennent la tête pleine de Hip Hop. Lui est mauvais en danse, sans aptitude pour le rap. Mais il sait dessiner. Et il n’arrêtera jamais. De retour en France, chez son père à Château-Thierry, il repeint la ville de La Fontaine. Puis, direction Paris, chez son oncle. Il décrit un jeune homme nerveux, rebelle et indomptable.
1986, il tague comme il respire. Il rencontre les amis qu’on ne perd pas, ceux du fameux collectif de graffeurs fondé par Ragtime, M.A.C. « On taguait, on partait en garde à vue, on sortait. On taguait, on repartait en garde à vue. On payait des amendes. On essayait tout. On touchait à la drogue, on allait dans les cata. Hip Hop, Punk, rock alternatif… A cette époque, tout est lié. »
De la rue au carré Hermès
Il n’a jamais payé de bombes de peinture de sa vie et reste évasif quand on lui demande comment il les trouvait. Ça trafique, c’est l’effervescence de la jungle urbaine et sauvage. Bastille, République, le XXe arrondissement… un vaste terrain de jeu pour exprimer son art.
C’est assez stupéfiant d’imaginer le parcours de Cyril Phan, du petit réfugié vietnamien à l’artiste incontournable qu’il est devenu. Difficile d’imaginer qu’il est à l’origine d’un carré Hermès pour la collection automne-hiver 2011-2012.
« Hermès, c’est une rencontre. C’est ça le graffiti, il te sort du ghetto. C’est un moyen d’exister autrement. Tu n’es pas que le petit réfugié, timide, qui parle mal la langue. C’est universel, il n’y a pas de classe. Tu peux être richissime ou venir de la pire favela. » Hermès, Moleskine, Nissan et toujours de grandes fresques sur les murs des villes du monde.
C’est en 1989, avec son pote Juan, qu’il commence à dessiner les lettres en volume, à les remplir. « L’un de nos premiers graff, on l’a fait à deux. On a écrit Peace, on s’est partagé les lettres. »
Il n’arrête plus le graff. Bientôt, les commerçants demandent des devantures. Au début ils se faisaient payer en bombes. « On demandait 50 bombes, on en utilisait 5 et le reste on l’utilisait pour nous. » Ensuite ils se sont fait payer. Aujourd’hui, Kongo peint en galerie, et revient de sa deuxième expo personnelle à Singapour. « Quand je peins une toile, je sais que ce n’est pas éphémère. Je veux que ça reste un patrimoine pour mes enfants. Ce n’est pas comme si j’étais dehors sous la pluie, à éviter les flics. » Sur la toile, application et remise en question.
La volonté de faire émerger le graffiti
Il a voyagé partout, il a rencontré les graffeurs des quatre coins de la planète. Et il s’est rendu compte, que le graff, ce n’était pas que Paris, Londres, Berlin et Amsterdam. « Dans les années 80/90, il y a avait des graffeurs dans toutes les capitales. Et maintenant, dans toutes les villes. Le graffiti, c’est une culture. »
Alors, il s’est mis en tête, avec d’autres, de faire comprendre aux médias que le graffiti était un mouvement qu’il ne fallait surtout pas négliger. Il a voulu le faire émerger en tant que discipline artistique, culturelle. « Et pas seulement en parler quand la RATP et la SNCF appellent les médias pour leur expliquer que c’est du vandalisme, que c’est le contribuable qui paie. »
Le pari est réussi, le graffiti est désormais reconnu. C’est pour les mêmes raisons qu’il a créé le festival Kosmopolite à Bagnolet, et fait de la ville un lieu de rencontre international. « Suite à tous les voyages avec le collectif M.A.C, après toutes ces rencontres, on a eu envie d’inviter nos potes pour faire la teuf, faire de belles productions et pallier au regard qu’ont les médias et le reste de la France sur le graffiti. »
Cyril Kongo Phan n’a jamais acheté de bombes de peinture et n’a jamais été salarié. « Tellement de gens subissent leur vie au lieu de la vivre que vivre comme tu l’as décidé, est, en soi, un acte militant. »
A la galerie Wallworks, sa relecture d’un siège de première classe de la RATP nous avait tapé dans l’œil. Cette exposition délicieusement ironique, "Ne pas effacer", qui expose en œuvres d’art du mobilier urbain graffé marche tellement bien que de nouvelles pièces ont été travaillées. Un nouveau siège passe entre les mains de kongo, de deuxième classe cette fois. Il trône au milieu de Narvaland.
> Ne pas effacer, jusqu’au 30 mai à la galerie WallWorks, 4, rue Martel, 75010, Paris.