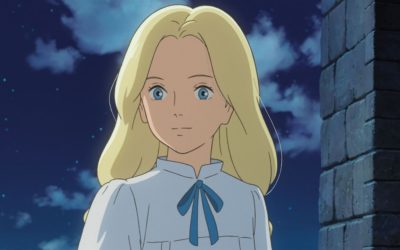Désormais adulte, Sophie (Celia Rowlson-Hall) plonge avec l’aide d’un film tourné vingt ans auparavant dans ses souvenirs de vacances d’été passées en Turquie avec son père Calum (Paul Mescal). Alors âgée de 11 ans, Sophie (Frankie Corio) profite pleinement de ces moments de complicité avec ce jeune père qu’elle ne voit plus si souvent depuis la séparation de ses parents.
Avec le recul, Sophie ressent plus précisément la sourde et invisible menace qui planait sur ce bonheur sur le point de disparaître. Dans ces souvenirs diffus qui sont autant d’indices, la jeune femme cherche des réponses à une question qui l’obsède depuis tant d’années : qui était réellement cet homme qu’elle pensait connaître comme un père ?
Fille au père
Avec Aftersun, Charlotte Wells explore de nouveau les thématiques du rapport père-fille et d’une perte inconsolable déjà évoquées dans Tuesday (2015), son premier court-métrage visible sur son site. Une première œuvre que la réalisatrice écossaise vivant désormais à New-York considère comme un « prequel avec un lieu et une époque différente » à l’histoire de Sophie.
Aftersun remonte à l’époque où la jeune cinéaste était encore à l’école de cinéma. Charlotte Wells retient notamment de cette période des films comme Alice dans les villes (1974) de Wim Wenders et La barbe à papa (1973) de Peter Bogdanovich. Deux œuvres sur l’enfance et la relation père-fille dont l’héritage cinéphile plane sur ces souvenirs estivaux.
Vagues de souvenirs
Au fil du temps, Aftersun est devenu un projet très personnel pour la cinéaste, fruit de nombreuses années à explorer ses propres souvenirs et à questionner sa relation avec son père. Cette introspection a permis à Charlotte Wells de comprendre d’où provenait ce besoin de réaliser ce film en particulier. Le poids de son propre vécu ne s’impose pourtant pas à son œuvre. Par sa justesse et son atmosphère éthérée, Aftersun capte des sentiments qui tendent naturellement vers l’universel.
Charlotte Wells est consciente des limites des souvenirs épars invoqués pour consoler une plaie jamais cicatrisée. L’aspect illusoire de cette tentative est au cœur de ce voyage temporel envoûtant produit notamment par Barry Jenkins, réalisateur du sublime Moonlight (2016) – lire notre critique – et de Si Beale Street pouvait parler (2018) – lire notre critique. Aftersun est parcouru par cette sensation que les vagues de souvenirs immortalisés par la caméra ne laissent derrière elles qu’une écume intangible de regrets.
Fugue temporelle
Cette quête perdue d’avance mais irrésistible est intimement liée à la forme du film, prévue pour être très conventionnelle à la base. Aftersun a lentement dérivé au montage vers une élégie temporelle nébuleuse où les journées semblent fusionner les unes avec les autres. Les souvenirs estivaux de Sophie sont d’une matière dont sont faits les rêves. Ces heures passées avec son père, dont une trace visuelle a été en partie conservée, sont désormais hors du temps, à la fois éternelles et à jamais perdues.
Si l’action se déroule sur une semaine, elle pourrait tout autant se dérouler sur des mois voire des années. Par le montage, Charlotte Wells invoque un temps mémoriel qui s’affranchit du cours du temps. Les souvenirs sont ainsi convoqués à l’envie par la puissance de la mémoire ou la simple pression sur le bouton lecture du caméscope gardien de la présence paternelle.
Comme si l’esprit de Sophie scannait des fréquences radio, les transitions des séquences se brouillent volontairement. Dans ce flot continue de souvenirs, les points de vue de Sophie et Calum prédominent. Leurs ressentis s’immiscent progressivement dans le récit et éclairent la compréhension du drame discret qui se noue en coulisses.
Du bleu au blues
Volontairement impressionniste dans sa conception du temps, Aftersun nous emporte dans un flot continu, refuge de moments familiers aussi réconfortants que mélancoliques par leur finitude. Cette impression de continuité est également ancrée dans Aftersun par son aspect formel. Les vacances de Calum et Sophie sont enveloppées dans des teintes de bleu pastel où le ciel et l’eau fusionnent pour créer un espace propice à la divagation mémorielle.
Cette teinte bleue apaisante symbolise le temps suspendu des vacances et les moments de joie partagés entre un père et sa fille, en marge du quotidien. Et d’une certaine réalité. Mais ce cocon estival qui les protège n’est pas totalement hermétique. Des silences pesants et la volonté de Calum de vouloir s’amuser en toute circonstance, comme si le temps manquait, augurent d’une ombre qui s’étend progressivement sur leur bonheur insouciant.
Limbes disco
Ponctuellement, cette menace latente se matérialise sous la forme d’une scène récurrente qui déchire l’homogénéité visuelle de ces lumineuses vacances. Aftersun est parcouru par cette scène énigmatique dont la répétition finit par faire sens. Elle montre Calum plongé dans l’obscurité dans ce que l’on imagine être une discothèque. Alors qu’il danse, son corps est révélé furtivement par des flashs de stroboscope.
L’invasion répétée de cette scène dans le film impose une autre temporalité, saccadée et aux sursauts incontrôlables. La pénombre donne corps à cette menace diffuse qui n’existait alors qu’en creux dans les regards et silences pudiques entre le père et sa fille. La scène intrigante infuse progressivement dans le reste du film. Elle le contamine et donne à des détails discrets un ton sombrement prophétique.
Perdu dans les limbes d’une discothèque où il danse seul, Calum n’existe plus que par ces flashs qui viennent donner corps à son existence. Une présence intermittente dans les limbes mystérieuses de cette piste de danse. À l’instar des souvenirs de Sophie qui le convoquent ponctuellement mais dont la tentative de compréhension et de résilience s’avère de plus en plus vaine.
Cocon sonore
La musique introspective composée pour le film par Olivier Coates accompagne subtilement cette rêverie mémorielle. Ses sonorités lancinantes forment un cocon sonore qui renforce cette impression de continuité. Le choix des morceaux entendus tout au long du film œuvrent également à ce voyage à bord d’une capsule temporelle du début des années 2000.
Vacances oblige, le titre Macarena fait une irruption avec sa chorégraphie incontournable. Il est accompagné de titres par Aqua, All Saints ou encore du Drinkin in L.A. de Bran Van 3000 pour marquer l’insouciance estivale du lieu choisi par Calum et Sophie. Autant de morceaux qui renvoient au lâcher prise des vacances mais aussi à une époque révolue et une autre conception du temps. Un monde sans téléphone portable, dans la réalité de l’instant, qui vient titiller la nostalgie d’une temporalité elle aussi disparue.
Par deux fois, Charlotte Wells utilise magnifiquement ces titres dans des scènes qui subliment leur signification intrinsèque. Ainsi Sophie chante Losing My Religion de R.E.M. lors d’un karaoké dans un contexte qui rend son interprétation approximative absolument déchirante. Le célèbre titre Under Pressure de Queen et David Bowie se retrouve joliment complété par Olivier Coates et accompagne une de ces sombres scènes de discothèque avec un effet saisissant. Délicatement manipulés, ces titres résonnent magnifiquement avec le sentiment de perte planant sur le film.
Spectre obsédant
Avec une délicatesse absolue, Aftersun dévoile progressivement les traces d’une incompréhension face à une absence insurmontable. Le spectre du désespoir qui se matérialise peu à peu offre au film sa ténébreuse et gracieuse beauté. Rêve nébuleux qui tente de se raccrocher à des images fossiles, la quête de sens de Sophie est d’autant plus déchirante qu’elle lui échappe irrémédiablement.
Il ne reste alors que ces images captées par le désormais vieux caméscope, mouvantes mais captives. Éternelles mais fantomatiques. Des résidus que Sophie complète avec des souvenirs qui ont échappé à l’objectif : un premier baiser adolescent, la sensation de chaleur des rayons du soleil et l’amour d’un père au spleen à jamais inaccessible. À la fois intime et universelle, Aftersun est une œuvre sublime dont la mélancolie fantomatique hante longtemps après son visionnage.
> Aftersun, réalisé par Charlotte Wells, Grande-Bretagne – États-Unis, 2022 (1h42)