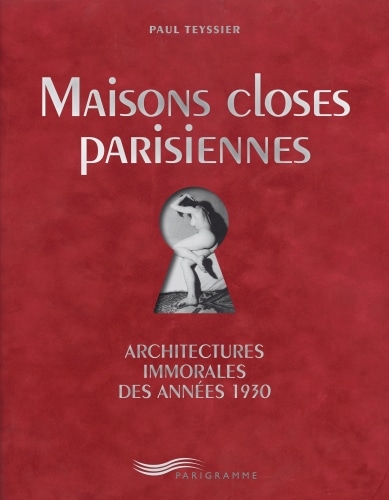Etudiant en architecture, Paul Teyssier travaille sur les liens entre le sexe et l’espace, à travers la littérature libertine du XVIIIe siècle notamment. Au hasard des recherches, il met la main sur les archives de la police, à Maubert Mutualité, des plans, des dessins, des témoignages, des comptes rendus, etc. Il réalise qu’il existe des programmes architecturaux propres à la maison close, un domaine d’étude sur lequel ne se sont pas encore penchés les sociologues et historiens qui ont pourtant beaucoup écrit sur le sujet. Pour Paul Teyssier, c’est le début de sept ans de recherche. Sujet d’étude ? La maison close, 1920-1946.
Quelles sont les différences entre les maisons closes ?
Il existe deux types de maisons. La maison de tolérance, avec une réglementation propre et qui occupe un immeuble entier. Et les maisons de rendez-vous, apparues en 1920. Les filles n’y étaient plus pensionnaires et le lieu n’occupait qu’un seul étage.
Dans les maisons de luxe s’articulent plusieurs séquences spatiales. Des salons, des corridors… des espaces de sociabilité, moment entre l’arrivée du client et la consommation charnelle, qui n’existent plus du tout dans les maisons d’abattage.
Ce n’est pas du tout la même organisation dans les maisons d’abattage où il y est surtout question de rendement. Pas de chambres, pas de salons d’apparat. Fini le décorum. Et, dans les rapports de police, les filles peuvent ne faire que deux passes par jour dans les maisons de luxe, une vingtaine dans les maisons d’abattage, au Fourcy, rue de Fourcy par exemple, une trentaine le week-end. Et on n’a pas le temps de s’arrêter dans des salons.
Quelles sont les spécificités des maisons closes de luxe ?
L’établissement est un dancing. On y trouve des phonographes. Les années 20 marquent l’arrivée de nouvelles musiques, les clients y dansent. C’était vraiment des lieux de sociabilité. Le Sphinx se situait, à Montparnasse entre le Dôme et la Coupole, des lieux de plaisir à la mode de l’époque. On boit un coup, on s’encanaille. Parfois, les clients ne consomment pas sexuellement.
Le bordel est coupé du monde
Concrètement, sur un plan d’architecte, comment se présente une maison close ?
Un bordel parisien se lit en coupe. Au sous-sol, se sont les coulisses de l’établissement. Avec les salles de maquillage, les bahuts pour les filles, la cantine. Au Sphinx par exemple, 60 filles étaient inscrites, 45 étaient présentes lors du contrôle. Au rez-de-chaussée, se tiennent l’espace de sociabilité, le dancing, le bar, le bar américain, les salons privatifs, avec des systèmes d’entrée un peu complexes, parce que la réglementation interdit que les bruits filtrent de l’intérieur à l’extérieur, des porte-tambour, des sas, des systèmes d’entrée compliqués. Le bordel est coupé du monde, c’est un lieu clos.
C’est pourquoi j’ai parlé d’architecture inversée. C’est fermé vers l’extérieur et ouvert vers des horizons complètement dingues, les chambres à thèmes ou très luxueuses, art déco au Sphinx. Elles se tiennent le long de l’escalier qui est la colonne vertébrale de l’établissement. Il est souvent décoré par les artistes et fait l’objet d’un travail spécifique. Au dernier étage, se trouvent les dortoirs des filles et les appartements des tenanciers.
Et dans les maisons d’abattage ?
Il n’y a rien du tout. On rentre. Il y a parfois une petite salle d’attente, parfois, des niches pour la consommation charnelle, le long de la salle. Un bouge sordide où on peut picoler, parfois des chambres. Mais elles ne sont pas aérées, elles sont exigües et sans fenêtre. C’est vraiment le strict minimum. La différence entre les deux se joue vraiment sur l’articulation espace-temps.
Vu de l’extérieur, à quoi ressemble une maison de tolérance ?
C’est un immeuble haussmannien qui se noie dans les immeubles voisins. De l’extérieur, rien ne se voit. La réglementation l’interdit. Elle autorise certains signes distinctifs, mineurs, mais qui deviennent très symboliques. Par exemple, le travail sur le numéro, décoré et un peu plus gros que sur les immeubles voisins. On note la fameuse lanterne rouge au XIXe qui tombe en désuétude au XXe siècle au profit de l’électricité. On voit alors des néons les remplacer.
Au Sphinx, à part une petite sculpture, une tête de sphinx sculptée au-dessus de la porte d’entrée, très discret, rien n’apparaît. D’ailleurs, c’était un problème pour les tenanciers qui voulaient attirer le client. C’était un commerce tout de même.
Des tenanciers très organisés
Qui sont-ils d’ailleurs ?
Des propriétaires qui avaient beaucoup d’argent. On parle là d’un commerce florissant notamment pour les propriétaires des maisons d’abattage qui rapportent beaucoup plus que les maisons de luxe. Les pontes sont des gars qui tiennent plusieurs maisons. Le gars du Fourcy, une maison d’abattage, est l’un des mecs les plus respectés du milieu parisien. Ils étaient très organisés, à deux ou plus, et avaient des parts dans différents bordels, maisons d’abattage ou maisons de tolérance. Seule une femme pouvait tenir la maison close. Les papiers étaient donc au nom des femmes. Des bourgeoises de l’époque, propriétaires d’un immeuble entier de Paris, c’était tout de même assez rare. Elles avaient une posture sociale particulière et importante. C’était tout de même l’homme qui tenait la maison mais il n’avait pas le droit d’y être. Ce n’était donc pas lui qui incarnait l’autorité auprès des filles.
Ça ressemble aux salons des femmes des Lumières, où se retrouvent les artistes et les intellectuels…
Oui. Au Sphinx, au One two two, au Chabanais, on rencontre Henry Miller, Kiesling. Ce sont des lieux qui ont toujours fasciné les artistes. Toulouse-Lautrec vivait au 6, rue des moulins, à la Fleur Blanche, et payait sa chambre en peignant des fresques. Il reste toute la cage d’escaliers dans cet immeuble. Les artistes ont d’ailleurs participé à cette idéalisation nostalgique du bordel, qui est complètement fausse et fantasmée. Le public a une vision du bordel à travers ces œuvres d’art, qui ne sont pas la réalité.
En quoi les maisons de tolérance sont-elles closes ?
Elles sont complètement coupées du monde par la réglementation. Les persiennes doivent être fermées. Les volets ont un système d’isolation très élaboré pour l’époque. Les verres sont opaques. L’architecture classique est ouverte sur la ville, on cherche l’extérieur. Là, c’est une façade, des filtres, comme un bunker, orientée vers l’intérieur, vers le fantasme, qui est la chambre, là où tout se passe. Il n’y a aucune relation avec l’extérieur.
Dans les maisons, existe-t-il un brassage social ?
C’est tout de même un cruel reflet de la société. Les couches sociales ne se mélangent pas beaucoup à part dans les maisons bourgeoises, entre la maison close de luxe et la maison d’abattage. Mais entre ces deux-là, on ne se mélange pas. Sauf certains artistes qui sont très attirés par les bouges sordides. Dans la maison bourgeoise, le rapport de police répertorie plusieurs professions lors d’une descente : un général, un dentiste, un artiste, un courtier, mais ça reste quand même des bourgeois.
Il s’agit d’une architecture tournée vers l’intérieur. Pourtant les bordels sont des centres névralgiques de la ville ?
J’ai réalisé une topographie du plaisir tarifié grâce au guide rose. En 1920, Paris compte deux cents bordels, ancrés dans le centre historique de Paris, rive droite, dans le quartier des Halles, le quartier historique de la prostitution. Elle était vraiment ancrée et très acceptée dans la ville alors qu’aujourd’hui, elle est rejetée dans la périphérie.
A l’époque, c’était une institution comme la Poste ou l’église. Elle fait partie du système : Etat, église, bordel.
Qu’apprend-on de la vie quotidienne des filles en étudiant l’architecture ?
L’architecture est le lien direct avec le social. Grâce à elle, on en apprend beaucoup sur son cadre de vie, avec quoi elle vit, comment elle vit. Aux archives, avec les plans, on trouve des rapports de police, on connaît les dettes des filles, les comptes, les dépenses. La confrontation des deux donne une vision juste de la vie d’une fille, en fonction de la classe sociale du bordel dans lequel elle travaille.
Et elles dorment toutes ensemble dans un dortoir ?
Avant oui, mais dans années 20, les mœurs ont évolué. Les filles arrivent à l’ouverture et repartent à la fermeture. Elles ne dorment plus dans les dortoirs. Mais malgré ça, elles restent complètement exploitées. Elles paient leurs serviettes, leurs savons, leur maquillage, les parfums, les robes, la bouffe. Ensuite, elles paient la part de la tenancière et la part du maquereau. Parce qu’une fille sans proxénète, c’est très rare. La maison de tolérance n’a jamais annihilé le trafic, la mafia, le milieu. Le maquereau restait à l’extérieur. Il attendait que la fille sorte pour prendre son dû.
En fait, il vaut mieux être en maison d’abattage, ça coûte moins cher en cosmétique pour une fille ?
Non, parce que le prix de la passe est de 35 francs au Sphinx plus les pourboires, alors qu’au Fourcy, c’est deux francs la passe. Et il faut quand même payer sa serviette, son savon. Vraiment, la maison d’abattage, c’est atroce, c’est le pire du pire. Les prostituées commencent jeunes dans les taules de luxe. Elles sont jolies. Mais si elles restent dans le milieu, elles finissent dans ces taules là.
Des lettres de dénonciation
L’ascenseur social existe-t-il dans la prostitution ?
Le rêve des filles, leur ascenseur social, c’est de devenir propriétaire et d’avoir leur propre affaire. Elles espèrent aussi sortir de la prostitution, en trouvant un homme qui tombe amoureux. Sinon, elles restent prostituées.
Dans L’Apollonide, le film de Bertrand Bonello, on découvre des filles soudées, entretenant des rapports ambiguës, et dont le maître mot est la solidarité. Qu’en pensez-vous ?
Il y avait beaucoup de concurrence entre les filles, comme le prouve, aux archives de la police, de nombreuses lettres de dénonciation, parfois très crues, envoyées à la sous-maîtresse ou directement au préfet de police. Elles accusent une autre fille ayant caché de l’alcool, en soupçonnent une d’entretenir une relation avec le patron, d’accepter des actes sexuels interdits, d’être malade, de n’être pas en règle, etc. Le but étant d’éliminer la concurrente, la faire renvoyer par les patrons ou les services de police. C’était loin d’être l’entente cordiale !
Jalousies d’argent mais aussi d’amour, certaines espérant avoir les faveurs du patron ou de la maîtresse de maison, ou entre elles ! Et puis, il ne faut pas oublier les maquereaux qui, derrière le décorum, sont les vrais patrons… Il y avait bien sûr une entraide, de l’amitié forte, de l’amour parfois entre certaines mais qui, je pense, d’un point de vue général, ne primait pas devant la dure réalité de leur métier. De plus, dans les bordels de luxe de la capitale et afin de satisfaire la clientèle, elles ne restaient pas au sein d’un même bordel très longtemps, ce qui devait aussi limiter les relations…
Qu’apprend-on sur les pratiques sexuelles de l’époque ?
On en apprend beaucoup ! La partouze est très à la mode. Le bordel, c’est quand même le lieu des fantasmes. Il doit répondre à tout. Et même pour les délires les plus fous, il existe toujours une maison où on trouvera ce qu’on cherche. Rue Saint-Sulpice, il y avait des bordels réservés aux ecclésiastiques, à l’ombre des tours de l’église. On y trouvait des reconstitutions de confessionnal où les prêtres pouvaient se taper des enfants de chœur, en fait des prostituées. Dans presque toutes les maisons se trouve la fameuse salle des tortures qui est souvent à la cave.
Existe-t-il un suivi médical des filles ?
C’est l’un des fers de lance des défenseurs des maisons closes, le contrôle des maladies vénériennes. Un médecin affilié visitait les filles deux fois par semaine. Une salle est réservée au examen, même dans les maisons d’abattage. Elle renferme le chameau, la table de gynécologie et tous les ustensiles. Les normes hygiéniques étaient vraiment strictes et se développaient à cette époque. Et si une fille développait une maladie, elle était envoyée dans un dispensaire.
Chaque bordel est obligé d’avoir une salle d’examen. Le XVIIIe siècle marque l’apparition des maladies vénériennes. On veut contrôler la prostitution pour contrôler les maladies. Pour un médecin comme Parent du Châtelet, le bordel était l’égout séminal de la ville, une soupape de sûreté pour la stabilité urbaine. Elles étaient contrôlées et visitées régulièrement. Mais ça n’a jamais empêché les maladies de croître, puisqu’il y a toujours eu des filles dans la rue. Celles qui n’avaient pas de contacts, pas les maquereaux ou qui n’étaient pas assez jolies.
Commissaire et tenancière main dans la main
Les descentes de police sont nombreuses dans les bordels. Quels liens entretiennent le milieu de la prostitution et la police ?
Il existe une relation ambiguë entre la prostitution et la police. Le milieu est une source d’information incroyable sur les mœurs des hommes politiques de l’époque. Tout est noté, des descriptions objectives avec les styles de l’époque. Les maîtresses de maisons avaient des rapports très particuliers avec les commissaires. Elles leur écrivent quand elles partent en vacances : « Mon cher commissaire ». Les descentes sont organisées pour pêcher des infos et contrôler les filles qui sont censées être encartées ou contrôler les travaux, voir si tout est bien aux normes strictes de la réglementation. Ils sont une trentaine de policiers, à la mondaine.
Et que pensez-vous du débat sur la réouverture des maisons closes ?
Il est ridicule et n’a aucun sens. La maison close, c’est l’exploitation des filles donc évidemment, il ne faut pas rouvrir des maisons closes telles que dans les années 20. Cependant, nier la prostitution est une hérésie. Je crois qu’il faut réfléchir à la prostitution par le lieu. Il faut l’intégrer à l’urbain. Notre société actuelle la nie et la prostitution trouve refuge dans des quartiers assez glauques. Il n’existe aucun lieu de reconnaissance spatial. Je pense qu’il en faut un.
Témoignage de Maria, travailleuse du sexe
Le débat sur les maisons closes est encore tabou en France. Ces maisons, on les appelait pourtant « système à la française » avant la loi Marthe Richard de 1946, année d’abolition de la prostitution réglementée en France.
Citazine a demandé l’avis d’une travailleuse du sexe, Maria, de Grenoble, également secrétaire générale du Strass.
Que pensez-vous des maisons closes ?
Nous sommes radicalement opposés à la réouverture des maisons closes. Le problème, aujourd’hui, est que si on parle de réouverture des maisons closes, on parle donc de réglementation de la prostitution spécifique. Nous ne voulons pas que celle-ci devienne légale uniquement à l’intérieur de ses maisons et toutes les autres formes resteraient clandestines, interdites et marginales. Certaines auraient peut-être un statut de prostituée, pour travailler dans des conditions déplorables alors que celles qui veulent rester indépendantes et libres ne pourraient toujours pas travailler en tant que telles. On aurait des droits que si on accepte de se faire exploiter dans le cadre d’une maison close.
Et si les deux étaient reconnus, qu’en diriez-vous ?
Pourquoi pas. Si la prostituée peut décider dans quel cadre elle veut travailler, nous ne sommes pas contre. Nous avons des positions très antiproxénétisme. Et la maison close, c’est l’instauration du proxénétisme en tant que tel, sauf que le proxénète prend le nom de patron. Si certaines filles préfèrent ce système, il n’est évidemment pas question de les en empêcher.
Selon vous, quel est le bon système ?
En Suisse, les prostituées ont le choix de la façon dont elles peuvent exercer leur travail : Internet, la rue ou le salon de massage. Certains de ces salons sont tenus par un patron. Ce sont des prostituées qui s’associent pour ouvrir leur propre lieu, de manière coopérative. Et c’est précisément ce qu’on réclame. Aujourd’hui, à cause des lois sur le proxénétisme, on ne peut pas s’associer. Ouvrir des lieux entre travailleuses du sexe pour recevoir nos clients, oui, ça on le souhaite. Mais pas les maisons closes tenues par un patron.
Il faut reconnaître le statut de travailleuses du sexe, revoir les lois sur le proxénétisme de soutien afin de permettre aux prostituées de s’associer entre elles dans leurs propres lieux. Actuellement, le propriétaire tomberait pour proxénétisme.
> Maisons closes parisiennes, architecture immorale des années 1930, Paul Teyssier, Parigramme, 2010.